Le château royal de Blois, situé dans le département de Loir-et-Cher, fait partie des châteaux de la Loire. Il fut la résidence favorite des rois de France à la Renaissance.

C’est un château ancien qui existe depuis le Moyen-Age mais qui a été remanié de nombreuses fois. En 1515, François 1er notamment rajoute une aile de style Renaissance et y commence une des plus importantes collections de livres de l’époque. La direction des travaux est donnée à l’architecte italien Dominique de Cortone à qui l’on doit l’escalier monumental.
De style Renaissance, l’architecture et l’ornementation sont marquées par l’influence italienne. Même si seulement douze ans séparent la construction de l’aile François Ier de celle de l’aile Louis XII, l’inspiration italienne a non seulement influencé les motifs décoratifs, mais aussi l’agencement et la forme complète de l’édifice. L’élément central de cette aile est l’escalier monumental, de type vis hors-œuvre, octogonal, dont trois côtés sont encastrés dans le bâtiment lui-même.
L’escalier

L’escalier couvert de fines sculptures Renaissance, d’ornements italianisants (statues, balustres, candélabres) et d’emblèmes royaux (salamandres, couronnes, « F » pour François Ier, « C » pour Claude de France), s’ouvre entre les contreforts par de larges baies sur la cour du château. Sa voûte dallée soutenue par des contreforts rectangulaires extérieurs, en font un symbole récurrent de l’architecture française à la Renaissance et annoncent les innovations de l’époque sur l’architecture des escaliers, qui deviennent, plus qu’un élément fonctionnel, un ajout esthétique majeur.
Les façades

Au revers de l’aile, accessible depuis la galerie de la Reine, se trouve la façade des Loges, construite à sept mètres en avant de l’ancienne courtine, caractérisée par une suite de niches non-communicantes. Ces loges, bien qu’inspirées de celles d’un palais au Vatican. Sa décoration présente entre autres des bas-reliefs sur les allèges des échauguettes représentant les douze travaux d’Hercule et d’autres scènes représentant le héros grec (Hercule et le centaure, Hercule et l’hydre de Lerne, Hercule et le taureau de Crète, Hercule et Antée, Hercule et Cacus notamment). Cette façade donnait autrefois sur les jardins créés par Louis XII.

Côté cour, la façade est ornée de fenêtres à meneaux alternés de pilastres aux chapiteaux italianisants, qui croisent les moulures entre les étages. La corniche au sommet de cette façade présente, superposés, une série de motifs de la première Renaissance. Elle court le long de la façade et contourne l’escalier monumental. La haute toiture et la présence de gargouilles le long de la façade montre néanmoins un héritage du style gothique qui n’a pas encore été complètement abandonné par les architectes.
Les fenêtres à meneaux sont emblématique de l’architecture de la Renaissance où elles apparaissent comme une composition de quatre baies. Dans cette période où la religion domine en marquant toute forme d’art, elle est conçue à partir des règles esthétiques du carré donnant le rectangle d’or contenant une croix.




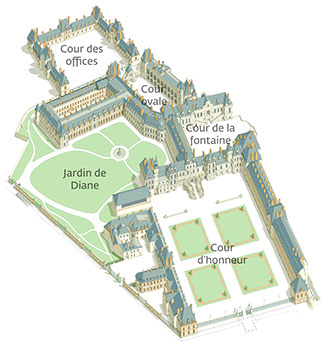


 Pendant la majeure partie du Moyen Âge, il n’y eut d’autres livres que les manuscrits, coûteux et rares, et la constitution d’une « librairie » ou bibliothèque était malaisée. Pourtant, la mise au point de la xylographie permettait déjà de reproduire des images grossières : en gravant sur une planche de bois à l’envers et en relief, des lettres et des images, puis en enduisant les parties en relief d’encre grasse, on pouvait démultiplier un message. Mais la xylographie ne permettait de reproduire qu’un texte déterminé, et les bois s’usaient rapidement.
Pendant la majeure partie du Moyen Âge, il n’y eut d’autres livres que les manuscrits, coûteux et rares, et la constitution d’une « librairie » ou bibliothèque était malaisée. Pourtant, la mise au point de la xylographie permettait déjà de reproduire des images grossières : en gravant sur une planche de bois à l’envers et en relief, des lettres et des images, puis en enduisant les parties en relief d’encre grasse, on pouvait démultiplier un message. Mais la xylographie ne permettait de reproduire qu’un texte déterminé, et les bois s’usaient rapidement.



 Léonard de Vinci est né le 15 avril 1452 dans les environs de Vinci, un petit village de Toscane, en Italie, près de Florence.
Léonard de Vinci est né le 15 avril 1452 dans les environs de Vinci, un petit village de Toscane, en Italie, près de Florence.










